VOS QUESTIONS, DES R - PowerPoint PPT Presentation
1 / 21
Title: VOS QUESTIONS, DES R
1
VOS QUESTIONS, DES RéPONSES
- Animation pédagogique du 14/04/15
- Enseigner la lecture au CP (2 partie)
- S. Snappe, S. Cazeaux-Vidal, V. Duprat
- Circonscription AGEN 1
2
Comment gérer lhétérogénéité ?
3
(No Transcript)
4
Une lecture découverte différenciée vidéo
tournée à lécole P. Bert à Agen, CP de Sandrine
Snappe
5
Comment susciter et développer lenvie et
lintérêt de lire ?
6
- En mettant en place des projets de lecture
littéraires et fonctionnels ! - Présentation du projet Lire avant daller à la
piscine Ecole Reclus à Agen, CP/CE1 de
Séverine Cazeaux-Vidal
7
DES RESSOURCES ?extrait du document
daccompagnement le langage a lécole maternelle
8
(No Transcript)
9
Dautres écrits, fonctionnels
10
(No Transcript)
11
Clarifions quelques définitions
- ECRITS
- Un écrit, cest un objet social, reconnaissable à
ses caractéristiques matérielles et porteur dun
message produit par quelquun et destiné à la
lecture de quelquun dautre. Les écrits peuvent
être regroupés par familles plus ou moins
génériques. La presse recouvre les journaux, les
magazines qui ont des caractéristiques communes
différentes de celles dune autre famille comme
les livres. Mais un journal est composé de
plusieurs écrits éditorial, faits divers,
météo Cest aussi le cas du manuel contenant des
écrits divers. - TEXTES
- Le texte est la face linguistique de lécrit
mots, phrases, cest la chair. Le complément du
texte est laspect matériel papier, couleur
(support). - GENRES
- Le genre apparaît comme une famille décrits
spécifiques à la littérature.
12
TYPES DE TEXTES Il existe de nombreuses
typologies de textes fondées sur des principes de
catégorisation différents.
- La typologie de Jean-Michel Adam qui a été
utilisée par la didactique du français, définit 8
types de textes - - le type textuel narratif présente des énoncés
daction on lobserve dans une nouvelle, un
conte, un témoignage, un énoncé de problème, dans
une BD, dans un film - - le type descriptif présente des énoncés détat
quon trouve en littérature (portrait,
description dobjet, de paysage), en publicité,
dans un inventaire, un guide touristique, un
dictionnaire, une grille de mots croisés, une
petite annonce - - le type explicatif a pour fonction de faire
comprendre ouvrages documentaires,
scientifiques, encyclopédies, dictionnaires,
légendes de schémas - - le type argumentatif vise à convaincre, à
persuader on en trouve des exemples dans le
discours politique, dans la publicité - - le type injonctif a pour fonction de faire
faire cest le cas des consignes, recettes de
cuisine, notices de montage, modes demploi,
règlements, règles de jeu - - le type prédictif a pour fonction de prédire
bulletin météorologique, horoscope, prophétie - - le type conversationnel ou dialogique
questionnaire denquête, bulle de BD, interview,
dialogue (romanesque, théâtral, pour
marionnettes, sketch) - - le type rhétorique ou poétique concerne les
textes où le jeu sur les mots et le rythme sont
déterminants, tels que poème, prose poétique,
chanson, slogan, proverbe
13
- SEQUENCE DE TEXTES
- Jamais un texte nest purement descriptif ou
narratif ou explicatif - La est donc une partie du texte, possédant des
caractéristiques linguistiques communes à toute
cette partie. Mais les textes ont généralement
une fonction densemble. Par exemple, si je dois
donner les raisons de mon retard, je vais
raconter les évènements, produire des séquences
descriptives, narratives pourtant la fonction
densemble du texte produit est explicative.
14
QUELLE PLACE DONNER A LA LECTURE ORALE ?
15
Quelques définitions
- La lecture à voix haute nest pas une étape
vers la lecture silencieuse mais comme
laffirment jean Foucambert et Evelyne Charmeux ,
elle suppose déjà une parfaite maitrise de la
lecture elle ne permet pas dapprendre à lire,
elle suppose quon sait lire . - La lecture à haute voix est une discipline à
part, appartenant à la maîtrise de loral prenant
appui sur la lecture extérieure à elle, qui doit
faire lobjet dun apprentissage spécifique,
naturellement second par rapport à la lecture. Il
faut avoir lu pour pouvoir lire à haute voix, il
faut savoir ce que lon a compris et ce que lon
veut faire comprendre. Bref, il faut avoir un
projet de communication et être capable de le
réaliser et cest ce quil faut apprendre.
16
- - La lecture orale pour autrui. Cest la lecture
communication le lecteur transmet à une autre
personne (ou plusieurs) des informations écrites
quil possède. Cest une activité qui relève
autant de la communication orale et parfois du
jeu dramatique que de la lecture stricto sensu. - - La relecture. Cest la lecture à haute voix
pour soi le lecteur relit pour lui-même le
texte quil a déjà lu une première fois afin
daméliorer ou de conforter sa compréhension ou
afin de passer dune première lecture (pour soi)
axée sur la compréhension littérale à une
deuxième forme de compréhension plus approfondie
ou plus fine. - - Le langage pour soi. Le lecteur (débutant ou
malhabile) "se dit" des morceaux de lénoncé
écrit, il parle à mi-voix pour saider à mieux
identifier des mots, à mieux mémoriser certains
éléments, à mieux organiser les informations
sémantiques, à mieux contrôler ou soutenir son
double travail de chercheur de mots et de
chercheur de sens. Il se sert du langage pour soi
comme outil intellectuel, comme instrument de
lexploration et de la reconstruction de
l'énoncé. ? SUB-VOCALISATION selon M. Brigaudiot
- Les élèves prononcent à voix chuchotée ce quils
essaient de lire car le sens ne vient pas de la
juxtaposition des mots posés les uns à la suite
des autres mais dune séquence sonore
correspondant à un énoncé dans une situation.
17
- Nombre denfants sont en difficulté parce quils
essaient ou/et parce quon leur demande de
"mélanger" deux pratiques de "lecture"
complètement différentes sonoriser une suite de
fragments écrits et comprendre le texte ou
bien dire à autrui le texte et le comprendre
ce "mélange" empêche ces enfants de se concentrer
sur la lecture pour soi ou lecture
compréhension. - Gérard Chauveau
18
Extrait de Lire au CP
19
(No Transcript)
20
(No Transcript)
21
(No Transcript)

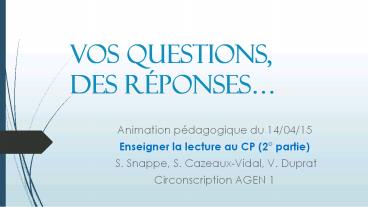




![READ [PDF] Le Guide Des Rhums Arrangés : Apprenez à Faire Des Rhums Comme Un Vrai Pirate (Tout Sur Le Rhum arrangé) (French Edition) PowerPoint PPT Presentation](https://s3.amazonaws.com/images.powershow.com/10081631.th0.jpg?_=20240719076)
![READ [PDF] Le Guide Des Rhums Arrangés : Apprenez à Faire Des Rhums Comme Un Vrai Pirate (Tout Sur Le Rhum arrangé) (French Edition) PowerPoint PPT Presentation](https://s3.amazonaws.com/images.powershow.com/10080998.th0.jpg?_=202407180712)























